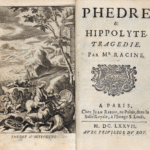Sur nos avenues, nous n’en avons que la version mutilée aux moignons difformes mais, non taillé, c’est un arbre à l’ombre généreuse. Je viens de découvrir que ce sont les grecs qui ont donné son nom à cet arbre venu d’Asie qu’ils avaient adopté pour rafraîchir les places où ils se réunissaient. Et le plus beau, c’est que place et platane ont la même racine hellénistique signifiant large, étendu. Joëlle Zask[1], la philosophe à qui je dois cette découverte démontre magnifiquement que c’est cette « place au platane » qui constitue la véritable place démocratique, loin de l’idéale agora ou de la démonstrative place de la République. C’est la place qui permet la vie collective, l’initiative et la rencontre parce qu’elle est ouverte, irrégulière, accueillante aux activités les plus banales mais aussi aux discussions sans fin à l’ombre des platanes. Nous nous sommes trop habitués à ne voir la démocratie que dans sa forme solennelle et mathématique, le platane et la place qui se déploie alentour convoquent un imaginaire démocratique moins abstrait, plus attentif au commun, au bien vivre et à la concorde. En parlant de concorde, quelques platanes seraient les bienvenus sur l’esplanade inhospitalière de la place de la Concorde qui, en l’état, porte si mal son nom !
Sur nos avenues, nous n’en avons que la version mutilée aux moignons difformes mais, non taillé, c’est un arbre à l’ombre généreuse. Je viens de découvrir que ce sont les grecs qui ont donné son nom à cet arbre venu d’Asie qu’ils avaient adopté pour rafraîchir les places où ils se réunissaient. Et le plus beau, c’est que place et platane ont la même racine hellénistique signifiant large, étendu. Joëlle Zask[1], la philosophe à qui je dois cette découverte démontre magnifiquement que c’est cette « place au platane » qui constitue la véritable place démocratique, loin de l’idéale agora ou de la démonstrative place de la République. C’est la place qui permet la vie collective, l’initiative et la rencontre parce qu’elle est ouverte, irrégulière, accueillante aux activités les plus banales mais aussi aux discussions sans fin à l’ombre des platanes. Nous nous sommes trop habitués à ne voir la démocratie que dans sa forme solennelle et mathématique, le platane et la place qui se déploie alentour convoquent un imaginaire démocratique moins abstrait, plus attentif au commun, au bien vivre et à la concorde. En parlant de concorde, quelques platanes seraient les bienvenus sur l’esplanade inhospitalière de la place de la Concorde qui, en l’état, porte si mal son nom !
[1] Joëlle Zask, Quand la place devient publique, éditions Le Bord de l’eau, 2018