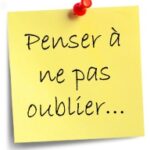J’ai éprouvé le besoin de m’asseoir à mon ordinateur. Et d’écrire. Le besoin de mettre en mots une émotion vague, une tristesse heureuse. C’est bizarre mais j’ai éprouvé pratiquement le même sentiment à chaque fois que j’ai regardé (souvent par désœuvrement mais avec ensuite l’impossibilité de décrocher) le récit de la carrière d’un chanteur : Montand, Reggiani, Berger, Gall, Hardy… Je ne suis pas fan de chanson pourtant, je n’écoute pratiquement pas les paroles, je n’ai pas de playliste et le silence ne me fait pas peur. En fait la chanson est pour moi le temps qui passe, les refrains d’une époque. Par exemple, mon service militaire, c’était Thriller de Mickael Jackson parce qu’à la cafet’ où se débouchaient les « Kros » de fin de journée, le tube passait en boucle. En réalité pour moi c’est même l’inverse : Thriller n’est rien qu’une grande salle carrelée éclairée au néon dans une caserne de Mourmelon-le -Grand !
Et quand un documentaire reprend toute la chronologie d’un chanteur que j’ai connu depuis ma jeunesse, c’est en fait une succession, plutôt un empilement d’émotions simples : des tranches de vie qui s’empilent. Comme je me projette plutôt dans l’avenir, le potentiel et l’anticipation par choix politique et existentiel, je n’ai pas tellement d’occasions de ressasser le passé. Le « à mon époque » ou pire encore le « c’était mieux avant » ne m’ont pas encore atteint malgré l’âge qui avance. En fait la plongée dans les chansons par ordre chronologique donne l’occasion de mesurer la profondeur du temps. La profondeur plus que la durée puisque toutes ces couches de temps sont bien là aujourd’hui simultanément. En 120 minutes à peu près, la vie ne défile pas comme dans un film, elle se creuse, se fore… d’où sans doute à la fin ce léger vertige, cette presque nausée.
J’ai ressenti ça aussi avec les cérémonies liées à la mort d’Elizabeth II. Cette sensation de plongée dans le temps. Beaucoup de commentateurs ont parlé d’un personnage « historique » qui symbolisait tout le XXème siècle. Mais ce n’est pas vrai, la reine n’était pas un personnage historique. Elle n’a pas fait l’histoire de son pays. Elle n’est pour rien dans le Thatchérisme, le Blairisme ou le Brexit. La reine n’est pas prise dans le temps événementiel, celui qui passe et dont on tente de mesurer les traces pour l’Histoire. Elle est l’Histoire déjà là, le temps qui ne passe pas, un condensé du temps. La monarchie anglaise a la capacité de faire ressurgir au cœur du XXIème siècle une profondeur de temps qui remonte au moins au Moyen-âge. Hallebardes, costumes de la Tour de Londres, trompettes, voutes en ogive… Nous comprenions que le temps ne passe pas mais qu’il s’accumule. Pour des contemporains, condamnés à l’immédiateté des réseaux sociaux et des chaînes info, c’est forcément perturbant ce temps qui ne passe pas. Il n’y avait que dans les interstices des minutes de silence, des chants grégoriens ou des marches militaires qu’on le percevait, quand la logorrhée des commentaires se taisait un instant, prise malgré elle dans l’épaisseur d’un temps qui s’abstrait de l’accélération.
Je suis né dans une famille qui, a connu une forme de dilatation du temps qui sans doute me rend sensible au fait que le temps ne passe pas. Mes trois vieilles tantes, non mariées, ont vécu ensemble la seconde moitié du XXème siècle dans un monde encore largement rattaché au XIXème siècle : bourgeoisie provinciale avec l’usine comme repère et comme ressource commune, des tableaux de famille, des cahiers où l’on conserve la mémoire familiale depuis la fin du XVIIIème siècle, des jeux d’autrefois (croquet et jacquet), des qualités surannées : discrétion, distinction et autarcie… Jusqu’à la vente de la maison familiale à la mort de ma dernière tante en 2020, j’ai passé mes étés dans cette atmosphère hors du … J’allais utiliser l’expression convenue « hors du temps » mais elle est absurde. C’était l’inverse : la vie à Bragette n’était pas hors du temps, elle était au contraire plongée dans le temps, dans une pluralité de temps qui cohabitaient.
C’est notre monde contemporain qui est aussi follement « hors du temps » qu’il est « hors sol » au sens que lui a donné Bruno Latour. Atterrir, comme il le demande, c’est aussi se souvenir, renouer avec la richesse des temps multiples. Pas de transition possible sans mémoire vive. Face aux pénuries d’eau, face à l’énergie chère, nous allons devoir convoquer les ressources de temps qu’on croyait à tort balayés par le progrès : les toilettes de chat, les cuissons à feu doux dans des marmites en fonte, les vêtement reprisés (ou upcyclés pour faire moderne)… Drame d’’une rupture avec l’insouciance ou réincorporation dans nos vies de l’attention aux choses ? Souchon, et c’est sans doute ce qui m’a tant ému hier soir, a capté tant d’airs du temps – sur cinq décennies déjà – sans jamais être ni ringard ni à la mode ! Sa nostalgie, sa capacité à faire vivre des temps apparemment passés, je la vois plutôt aujourd’hui comme une alerte face à nos oublis et nos inconséquences. Il nous appelle à ne plus balancer nos petits moments magiques !
Tous ces petits moments magiques
De notre existence
Qu’on met dans des sacs plastique
Et puis qu’on balance
Tout ce gaspi de nos cœurs qui battent
Tous ces morceaux de nous qui partent
Merci à tous ceux qui m’ont envoyé un mot à la parution du texte sur la « fin de persopolitique », ça m’a touché. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être que j’avais juste besoin d’exprimer la frustration de mon ego… On verra si l’envie d’écrire ici revient comme avant. Et pourquoi pas après tout ?!