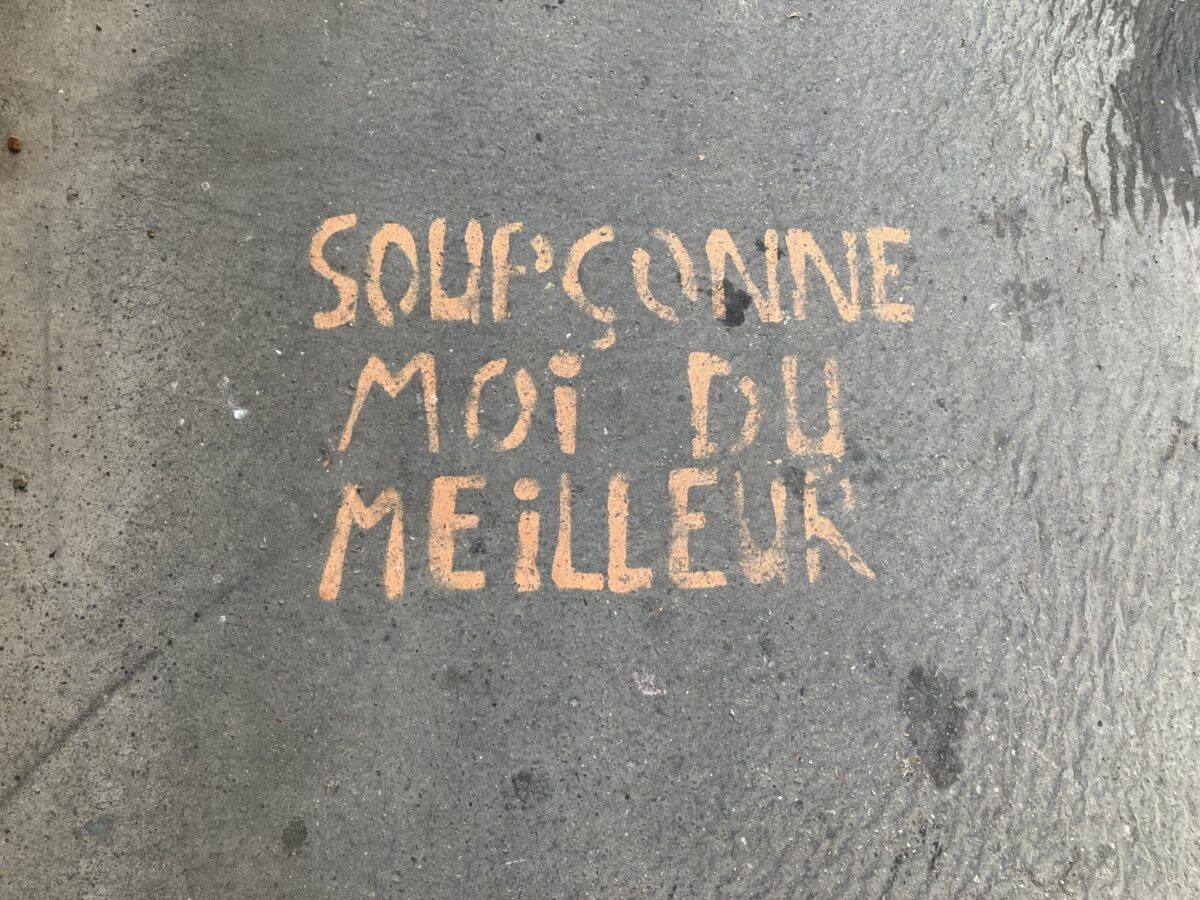Un mercredi après-midi sous les platanes d’une place d’Arles pendant le festival Agir pour le Vivant. La canicule est poisseuse, épuisante et pourtant nous sommes une dizaine à nous être réunis pour « faire le plein » à la station-service dont je suis le pompiste bénévole. Pas de pompes à essence, pas non plus de bornes de recharges, simplement 8 femmes et deux hommes réunis par l’envie de découvrir une manière de recharger ses propres batteries … en énergie citoyenne. Le principe est simplissime : nous avons tous quelque chose à partager qui peut aider ceux qui l’entendent à repartir renforcés de quelques idées, pratiques, expériences, lectures… de tout ce que les unes et les autres auront accepté de confier au cours d’un tour de parole.
Chacun.e se lance à son tour. On hésite un peu : « Je ne sais pas si c’est bien le sujet… ». J’essaie de rassurer en disant qu’on ne peut pas être hors sujet quand on évoque sincèrement un vécu personnel régénérateur. Les vacances sont encore proches, des expériences se partagent spontanément : woofing dans plusieurs fermes pour multiplier les découvertes, activités joyeuses de l’Espace des possibles, bains dans les eaux glaciales d’un lac de montagne… Nous faisons aussi notre moisson de lectures inspirantes ou de rencontres décalées. Certaines partagent simplement, et ça fait du bien, leur enthousiasme, l’une pour un chihuahua ( !), l’autre pour les athlètes du championnat du monde sans une once de chauvinisme ! Continuer la lecture de « Face aux larmes »