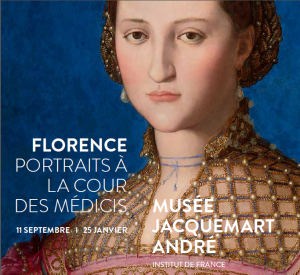Le drapeau, comme le dit son étymologie, était avant tout un morceau de tissu, une pièce de drap. J’ai appris qu’au cours de son histoire, il a désigné les langes dans lesquelles on drapait un nouveau-né ! Aujourd’hui les trois couleurs se dématérialisent en lumière pour recouvrir les profils facebook comme pour habiller les monuments. Comment rester insensible à ces illuminations trouant l’obscurité des nuits d’ici et d’ailleurs ? Cet habit de lumière sur l’Assemblé Nationale en a fait frissonner plus d’un. Le symbole, quand il perd son support matériel – hampe et tissu – semble perdre aussi sa connotation antérieure de panache auquel on est sommé de se rallier. Le drapeau ne serait plus l’oriflamme des armées mais l’expression de l’universalisme français. Alors, fallait-il pavoiser balcons et fenêtres ce vendredi ? N’oublions pas que nous n’utilisons plus ce vieux mot de « pavoiser » que dans le sens « il n’y a pas de quoi pavoiser »! On retrouve la matérialité d’avant, celle notamment des fanions agités sur le chemin des libérateurs de 1944. Ne risque-t-on pas la forfanterie en réactivant maintenant un symbole de victoire ? Je comprends l’intention de fierté et de rassemblement. Je préfère la proposition plus en retenue qui nous a été faite à Lyon, en lieu et place de la Fête des Lumières : renouer, plus massivement que ces dernières années, avec la tradition des luminions sur les bords des fenêtres. De la religion sécularisée plutôt que du patriotisme revivifié. Et si nous avions plus besoin de l’une que de l’autre en ce moment compliqué ? Et si nous préférions la lumière au tissu ?!
Le drapeau, comme le dit son étymologie, était avant tout un morceau de tissu, une pièce de drap. J’ai appris qu’au cours de son histoire, il a désigné les langes dans lesquelles on drapait un nouveau-né ! Aujourd’hui les trois couleurs se dématérialisent en lumière pour recouvrir les profils facebook comme pour habiller les monuments. Comment rester insensible à ces illuminations trouant l’obscurité des nuits d’ici et d’ailleurs ? Cet habit de lumière sur l’Assemblé Nationale en a fait frissonner plus d’un. Le symbole, quand il perd son support matériel – hampe et tissu – semble perdre aussi sa connotation antérieure de panache auquel on est sommé de se rallier. Le drapeau ne serait plus l’oriflamme des armées mais l’expression de l’universalisme français. Alors, fallait-il pavoiser balcons et fenêtres ce vendredi ? N’oublions pas que nous n’utilisons plus ce vieux mot de « pavoiser » que dans le sens « il n’y a pas de quoi pavoiser »! On retrouve la matérialité d’avant, celle notamment des fanions agités sur le chemin des libérateurs de 1944. Ne risque-t-on pas la forfanterie en réactivant maintenant un symbole de victoire ? Je comprends l’intention de fierté et de rassemblement. Je préfère la proposition plus en retenue qui nous a été faite à Lyon, en lieu et place de la Fête des Lumières : renouer, plus massivement que ces dernières années, avec la tradition des luminions sur les bords des fenêtres. De la religion sécularisée plutôt que du patriotisme revivifié. Et si nous avions plus besoin de l’une que de l’autre en ce moment compliqué ? Et si nous préférions la lumière au tissu ?!
Drapeau
Au moment où nous sommes appelés à « pavoiser », une réflexion rapide sur le drapeau et les 3 couleurs.