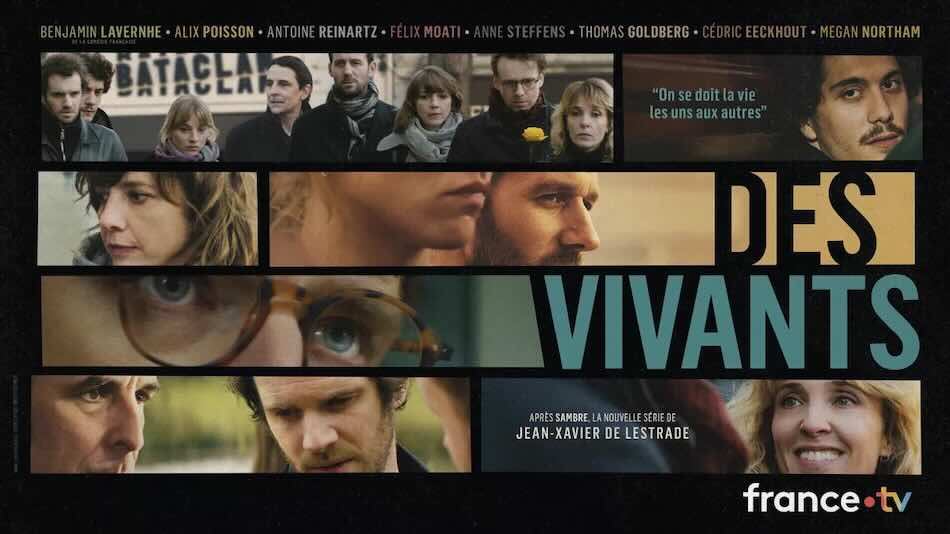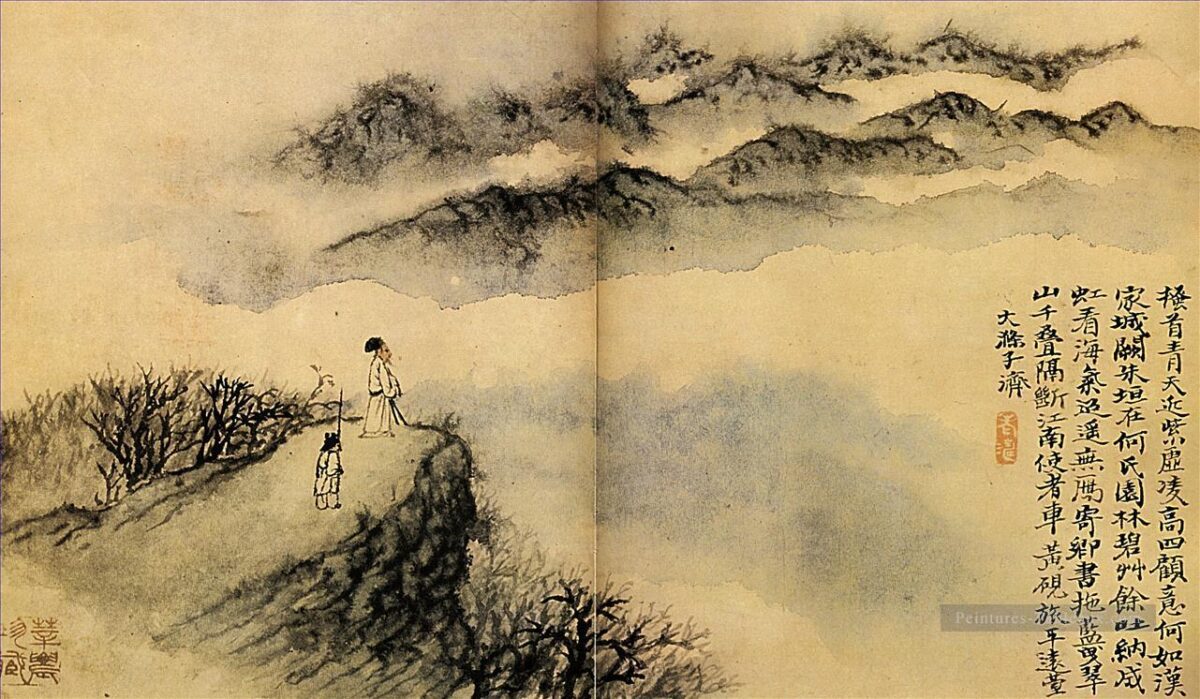Une lettre au contenu enrichi pour un nouveau mode de dialogue avec les lecteurs
Jusqu’ici la newsletter se limitait à l’envoi du dernier texte publié. J’ai envie de donner plus d’intérêt à la lettre et d’en faire un outil de dialogue.
Avec l’aide de Philippe Cazeneuve qui prend le relais de Michel Scriban pour le support technique, je vous propose un nouveau rendez-vous, plus riche, avec 3 ou 4 rubriques renvoyant au blog :
– Nouveau : l’annonce du dernier article paru
– Rétro-éclairage : un retour sur une actualité passée pour rétro-éclairer le présent
– Le mot du mois : la mise en avant d’un mot sur lequel j’ai écrit
– Conversations : le lancement d’une conversation (voir ci-dessous), dans le cadre d’une nouvelle rubrique.
Peut-on engager une conversation véritable avec un blog et une newsletter ?
C’est ce que je vous propose d’explorer ensemble, avec cette édition renouvelée de la newsletter de persopolitique et la création d’une rubrique « conversations » sur le blog.
Un blog appelle des commentaires, souvent intéressants mais toujours limités ; une newsletter fonctionne presque exclusivement à sens unique. Et si nous dépassions ensemble ces contraintes ?
Je constate, dans la vraie vie, une soif de conversations substantielles, de conversations qui permettent la multiplication des points de vue, le partage d’expériences vécues. Persopolitique vous propose un exercice inédit de « conversation écrite ».
Comment ça marche ?
1/ Vous découvrez en quelques mots un sujet sur lequel la pluralité des points de vue peut aider à voir plus clair. C’est un appel à contributions libres : vous pouvez écrire quelques lignes ou quelques pages : piste d’action, partage d’expérience, initiative à connaître, lecture stimulante,…
2/ A partir des contributions reçues, je rédige un texte qui reprend les propos reçus en les agençant pour qu’ils se répondent, se complètent et offrent ainsi un premier tour de la question. Cette conversation est publiée sur persopolitique comme un article de blog à part entière, avec mention de tous les contributeurs.
3/ la conversation se poursuit via les commentaires ouverts à tous. Si la richesse des commentaires le justifie, une nouvelle publication pourra être envisagée sur le même thème.
Pour que cette lettre fonctionne et pour enrichir le blog ensemble, merci de vous abonner ou de renouveler votre abonnement. J’espère vraiment que chacune et chacun de vous fera le geste de s’abonner !
Merci de votre intérêt et de votre confiance
Hervé CHAYGNEAUD-DUPUY