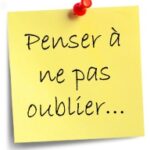 Replongé dans les débuts de la guerre en Ukraine avec le documentaire de Guy Lagache, je me rendais compte avec stupéfaction à quel point ma mémoire était défaillante : l’Irpin découvert au début de la guerre comme point limite de l’avancée des Russes aux portes de Kiev était la ville où plus tard les cadavres jonchaient les rues… et je n’avais pas fait le lien ; le sommet de Versailles m’était complètement sorti de la tête, etc. Il y a quinze jours, je partageais l’émotion et la colère d’Abdennour Bidar face à l’oubli dans lequel on rangeait rapidement le Covid comme s’il était temps de passer à autre chose sans faire l’indispensable retour sur ce qui s’est passé depuis deux ans.
Replongé dans les débuts de la guerre en Ukraine avec le documentaire de Guy Lagache, je me rendais compte avec stupéfaction à quel point ma mémoire était défaillante : l’Irpin découvert au début de la guerre comme point limite de l’avancée des Russes aux portes de Kiev était la ville où plus tard les cadavres jonchaient les rues… et je n’avais pas fait le lien ; le sommet de Versailles m’était complètement sorti de la tête, etc. Il y a quinze jours, je partageais l’émotion et la colère d’Abdennour Bidar face à l’oubli dans lequel on rangeait rapidement le Covid comme s’il était temps de passer à autre chose sans faire l’indispensable retour sur ce qui s’est passé depuis deux ans.
Oubli personnel, oubli collectif. Nous oublions de plus en plus vite, assommés par une actualité qui ne nous laisse aucun répit : catastrophes climatiques en série, épidémie, guerre, crise économique… Face à l’oubli, le pire, le tragique même, Jacques Brel l’a très bien résumé : On n’oublie rien de rien / On n’oublie rien du tout / On n’oublie rien de rien / On s’habitue c’est tout… C’est un peu ce qui m’est arrivé avec Irpin. Avec l’habitude, on ne traite plus l’information : on la reçoit, elle vous ébranle mais elle n’est plus intégrée, reliée. En quelque sorte, elle reste à l’extérieur, on « refuse » de l’assimiler. Cette habitude n’est pas de l’indifférence, c’est une protection, un réflexe de survie face à l’agression de trop. On a tous vécu cette bulle de protection qui nous offre de rire avec nos proches alors qu’on est en train d’enterrer un membre aimé de la famille. Cet oubli ou plutôt cette mise à distance du chagrin contribue aussi à notre sauvegarde. Oui, nous avons besoin de l’oubli et les vacances qui approchent, on le sait, vont nous couper utilement de cette actualité tellement anxiogène. Le vide, la vacance, que nous offrent les vacances sont des ressources précieuses.
Mais on ne peut pas en rester là, naturellement. L’oubli est un moment mais il ne doit être qu’un moment. Il faut sortir de l’oubli. Se rappeler ? se souvenir ? Aucun de ces deux mots ne dit vraiment le travail que nous avons à faire. J’oublie / je me rappelle. Comme s’il y avait une inversion naturelle de l’oubli. On/Off. J’oublie / je me souviens. C’est un autre registre, le passé revient à la mémoire et reste un souvenir, il ne fait que colorer le présent de nostalgie. Plaisant et triste, le souvenir n’est qu’une carte postale jaunie, la consultation de ses archives personnelles. Le travail contre l’oubli dont nous avons besoin est d’un autre ordre. Il nous faut… « désoublier ». Et ce n’est pas ce qu’on appelle le « devoir de mémoire » un mot qui m’a toujours agacé par son caractère injonctif, moralisateur (le bien et le mal sont connus et figés dans l’éternité). Il ne s’agit pas ici d’un « plus jamais ça » mais plutôt d’un effort pour examiner à nouveaux frais ce qu’on a trop vite choisi d’oublier. Abdennour Bidar le dit très justement à propos du Covid dans la tribune publiée par Le Monde que j’évoquais plus haut :
Il nous faut un très large débat démocratique « pour prendre soin et nous soigner collectivement de tous les traumatismes qui nous ont été imposés, pour retisser les liens déchirés, pour réparer les injustices subies, pour être particulièrement attentifs aussi aux risques futurs de la suspension certes provisoire mais inquiétante de nos libertés pendant la crise ».
Plus que le terme de débat, toujours chez nous indissociable de la confrontation des opinions, j’utiliserais volontiers le terme de conversation. Une grande conversation à travers tout le pays au cours de laquelle on peut se dire les choses franchement mais dont on attend surtout la capacité à imaginer un avenir où la santé devient véritablement notre affaire à tous. Et là nous saurons inventer d’autres manières de vieillir que dans des Ehpad, d’autres manières de rester en bonne santé qu’en ingurgitant toujours plus d’antidouleurs, d’autres manières d’interagir avec les soignants que de les applaudir à 20h et de les injurier aux urgences.
Désoublier, nous devons le faire tout autant à propos de la guerre en trouvant des manières d’être solidaires des Ukrainiens, peut-être, par exemple, en acceptant collectivement de rouler seulement à 100 km/heure sur la route de nos vacances (pour consommer moins d’énergie et réduire ainsi très sûrement les ressources de Poutine).
Désoublier est bien sûr encore plus indispensable par rapport à la crise du Vivant et la crise climatique pour avancer vraiment vers la frugalité qui nous rendra enfin possiblement heureux hors des addictions multiples qui sont celles de la société de consommation. Multiplions les conversations, les échanges pour que naissent des envies d’agir à la hauteur de l’enjeu qui est le nôtre pour maintenir l’habitabilité de notre monde. L’oubli nous aide à survivre mais il est urgent que nous comprenions que le désoubli, seul, nous aidera à vivre.
Au fait, pour les Québécois, désoublier, c’est sortir de l’état d’ivresse, c’est désaouler ! Mais en réalité notre oubli est bien une forme d’ivresse, de refus de la réalité ! Sachons donc oublier ET désoublier. Mais surtout, n’oublions pas de désoublier à la rentrée.


