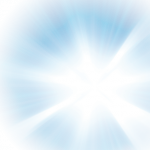J’ai souhaité exceptionnellement publier un texte que je n’ai pas écrit. Il l’a été par Jean-Pierre Worms et diffusé à la fois dans les réseaux des intellectuels convivialistes et ceux du Pouvoir citoyen en marche. Certains d’entre vous connaissent bien Jean-Pierre Worms, il a accepté dès l’origine de participer à l’orientation des Ateliers de la Citoyenneté, il a récemment rédigé la préface de mon livre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez simplement que c’est un jeune homme de 80 ans qui a été tour à tour ou simultanément sociologue, élu local et national, acteur associatif innovant. Toujours actif, toujours prêt à s’enthousiasmer pour une nouvelle aventure. Je trouve important de partager ses alertes et surtout les moyens qu’il propose pour faire face à l’urgence. Avec son autorisation je n’ai repris que ses propositions finales, les lecteurs de ce blog sont en effet familiers des prémisses de son discours qui forment aussi la trame de mes écrits : la crise démocratique née « des logiques mortifères de la démesure à l’œuvre dans tous les domaines [qui] convergent et s’accélèrent » et aussi les ressources qui naissent de cette même crise, avec « la pertinence et la puissance des savoirs d’expérience et du pouvoir d’agir des citoyens ». Jean-Pierre Worms pointe les difficultés du passage entre le monde qui se meurt et celui qui émerge. C’est ici que je lui laisse la parole.
Deux difficultés, parmi bien d’autres sans doute, doivent être particulièrement soulignées car elles appellent de fortes mobilisations pour les surmonter.
La première tient à l’émiettement de cette diversité d’initiatives qui freine la construction d’une capacité commune de transformation sociale, d’un véritable pouvoir politique partagé.
Si, comme le veut notre tradition française, certaines initiatives novatrices se diffusent sur le territoire selon la rationalité décentralisatrice descendante d’une organisation de type fédéral, la grande majorité de ces «créatifs culturels», de ces «défricheurs» et «innovateurs sociaux», dont les initiatives «partent du bas» et sont liées aux spécificités de leurs territoires d’émergence, se méfient du risque d’aliéner leur liberté d’initiative dans la participation à toute forme d’organisation collective supérieure et du moins n’en voient pas l’utilité. Isolées les unes des autres et sans aptitude à intervenir ensemble dans l’espace public, leur visibilité médiatique et leur pouvoir transformateur ne correspond pas au poids réel des volontés, intelligences et compétences citoyennes mises en mouvement.
Un autre facteur encore plus grave freine la mise en synergie de ces initiatives : la reproduction au sein de la société civile de ce découpage de la société en «silos» verticaux déconnectés les uns des autres qu’opère le traitement administratif centralisé des problèmes sociaux. L’emploi, l’éducation, le logement, la santé etc. relèvent de champs de compétence particuliers, encadrés par des contraintes règlementaires, des corps administratifs et professionnels et des modes de financement spécifiques qui freinent, voire parfois interdisent les possibilités d’élaborer dans la concertation des politiques publiques cohérentes sur les territoires où elles sont mises en œuvre. Cela est souvent dénoncé concernant l’action publique de l’État central. Moins souvent, alors que cela mériterait de l’être, concernant celle des collectivités locales. Exceptionnellement seulement concernant l’action des associations, réseaux ou collectifs citoyens, ce qui est encore plus grave.
C’est pourtant un constat que chacun peut faire. Sur un même territoire local, il y a ceux qui travaillent à l’ouverture de l’école aux familles qui en sont les plus éloignées, ceux qui permettent l’accès à la création d’entreprise à des personnes dont le statut financier et social les en écarterait, ceux qui œuvrent à l’amélioration de la prise en compte de l’intelligence et de la volonté des malades dans l’organisation des soins…, mais tous ces citoyens qui agissent pour développer et valoriser le «pouvoir d’agir» des personnes concernées par une politique publique, tous ces membres d’une société civique active, bien que mus par les mêmes valeurs, les mêmes désirs, les mêmes idées de la société… ne se connaissent pas!!! et de ce fait ne constituent pas une force capable de peser ensemble sur l’organisation et la mise en œuvre cohérente des politiques publiques sur leur territoire commun. Construire des relations transversales, de l’inter-connaissance et de l’inter-action sur les territoires locaux, un pouvoir d’agir partagé, voilà ce que les convivialistes et tous les citoyens actifs devraient entreprendre partout et de toute urgence. C’est pourquoi il importe de profiter de cette journée d’occupation de l’espace public le 24 septembre prochain [demain !!], initiée par «Alternatiba» et le «collectif pour la transition», pour mettre en pleine lumière conjointement ce que les citoyens ont entrepris pour construire, chacun séparément, cet autre monde plus juste, plus libre, plus convivial… et plus durable auquel aspirent tant et tant de nos concitoyens. Et pourquoi ne pas interpeller à ce propos ceux qui, dans quelques mois, vont solliciter nos suffrages? La démocratie doit se reconstruire en inversant le rapport entre les citoyens et leurs élus: au lieu que ce soient des candidats qui demandent aux citoyens d’approuver leurs «programmes», que ce soient les citoyens qui demandent aux élus d’approuver et de mettre en œuvre leurs propositions et de faire une place à leurs initiatives dans l’espace public.
Encore faut-il que le «personnel politique» soit apte à entendre ce message et que l’action publique soit apte à s’enrichir de l’intelligence et de l’action des citoyens. Deux questions doivent être prises en compte :
- celle du statut de la «représentation politique» pour l’ouvrir largement à la participation d’un nombre de citoyens beaucoup plus important qu’aujourd’hui (interdiction absolue de tout cumul de mandats et limitation dans le temps de leur exercice, transparence financière et sanction rigoureuse des conflits d’intérêt, tirage au sort de certaines instances de contrôle voire de délibération, référendums…),
- celle de l’élaboration de la décision, de sa mise en œuvre et du statut et de l’organisation des fonctions et des institutions publiques pour faire une large place à une élaboration partagée et à une co-gestion de l’action publique, voire à une gestion publique déléguée à des organisations de citoyens.
Laisser ces questions en friche et croire qu’on peut les ignorer et se désintéresser de la politique instituée et notamment des prochaines échéances électorales, bref traiter des problèmes socio-économiques sans se préoccuper de leur inscription dans les cadres actuels de la démocratie conduit selon moi à une impasse. Nous devons élaborer les moyens juridiques et institutionnels qui permettront la mise en œuvre de notre volonté de transformation sociale et les porter dans les débats politiques à venir !
____
A noter, Gérard Mermet, avec qui nous envisageons un texte commun, évoque de son côté la nécessité de la disruption et du collaboratif en politique. Une chose est sûre, nous ne pouvons pas nous contenter de la manière dont les candidats aux différentes primaires envisagent leur rôle. Il est plus qu’urgent qu’ils prennent au sérieux la richesse des propositions de la société civile !!