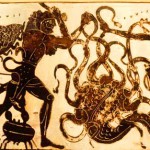Donc la France est en guerre. J’ai déjà écrit ici la réticence que j’avais à nommer « guerre » la situation. J’ai concédé, en commentaire à une interpellation vigoureuse, que l’organisation Etat Islamique nous fait bien la guerre mais que je m’interroge sur la pertinence de lui faire en retour la guerre sur notre territoire. Je comprends bien nécessité de se battre contre les terroristes. De mener des assauts y compris avec des militaires. Je comprends bien la nécessité de l’état d’urgence pour pouvoir faire rapidement des perquisitions. Pourtant le malaise persiste. Pourquoi, alors que j’accepte les mesures prises par le gouvernement, je me sens aussi peu en phase avec ce qui est en train de se passer ?Quand les symptômes persistent, on dit qu’il faut consulter un médecin. Il n’y a pas de médecin face à ce type de malaise ! Le seul remède que je connaisse, c’est de m’arrêter, de réfléchir et de me mettre à écrire. Un malaise ? en réalité plutôt trois, que je résume ainsi : « eux », « nous », et moins ce que nous faisons que « ce que nous ne faisons pas ». Voilà mes trois malaises. Détaillons.
« Eux ».
« Eux », ce sont les terroristes et Daech. Écoutons comme nous parlons d’eux. « Il faut les éradiquer, les détruire ». On ne parle plus d’ennemis qu’il faut vaincre mais de nuisibles qu’il faut éliminer. Ce ne sont plus des humains mais des parasites. On trouvait Poutine caricatural et dangereux lorsqu’il disait qu’il allait « poursuivre les tchétchènes jusque dans les chiottes ». N’est-on pas en train d’adopter le même langage ? Un ennemi, aussi terrible soit-il, doit être compris. On n’en fait même plus l’effort. Pourtant sur les nombreux plateaux télé que j’ai suivis, les multiples points de vue que j’ai lus, des intellectuels et des chercheurs ont tenté d’éviter les simplismes… sans apparemment être beaucoup entendus. J’ai retenu une notion qui me semblait a priori utile. Xavier Crettiez parlait d’un « terrorisme apocalyptique ». Après le terrorisme idéologique des années de plomb, serait venu le temps d’un terrorisme religieux tourné vers la réalisation, ici et maintenant, de la Révélation de la fin des temps. Pas des fous, pas de monstres, des êtres rationnels mus par une rationalité qui nous est désormais totalement étrangère.
Même s’il y a sans doute une part de vrai dans cette mystique, cet ésotérisme de la lutte armée, je pense avec le sociologue Raphaël Liogier qu’il ne faut pas écarter la dimension sociale de la réalité du terrorisme. Il disait sur un plateau télé qu’il y avait deux salafismes relativement étanches l’un à l’autre, celui qui a trait aux mœurs qui contraint les corps et les esprits (voile, barbe, rigorisme, soumission des femmes,…) et celui du jihad, qui ne nait pas dans les mosquées. La désintégration le film de Philippe Faucon (l’auteur de l’excellent Fatima) qui raconte comment trois jeunes se radicalisent, décrit bien ce processus avec un « instructeur » très critique à l’égard de l’islam des mosquées.
Raphaël Liogier a répondu longuement aux journalistes des Inrocks. Allez voir son argumentation, elle est assez convaincante. Voici juste la manière dont il résume son point de vue :
Le jihadisme ne vient pas du communautarisme, mais au contraire de la désocialisation, y compris de la communauté. On dit radicalisation, mais ce n’est pas le cas non plus. On prend le problème du mauvais côté. Les jihadistes ne commencent pas par le fondamentalisme, ils commencent par l’intention de nuire, par l’intention du combat. Il ne faut donc pas s’attacher aux milieux islamistes en premier lieu, car c’est déjà trop tard, les jihadistes potentiels y sont imperceptibles. Il faut prendre le processus en sens inverse.
Ce matin je lisais l’entretien de Bernard Stiegler dans Le Monde. Il pointe, lui, les raisons économiques de la dérive actuelle :
Ce n’est pas de guerre contre Daech qu’il s’agit, mais de guerre économique et mondiale, qui nous entraînera dans la guerre civile si nous ne la combattons pas. L’emploi va s’effondrer, notamment auprès des jeunes. Et le désespoir engendre la violence… On ne produit plus de raisons d’espérer aujourd’hui.
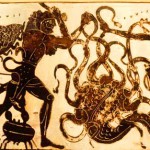 Si nous pensons que les terroristes sont des monstres que l’on peut éradiquer, si l’on croit que vaincre militairement Daech suffira à éteindre l’envie de Jihad du Moyen-Orient et d’ailleurs, c’est se tromper lourdement. Le jihadisme est une hydre dont les têtes repoussent au fur et à mesure qu’on les coupe. Nous avons la mémoire courte ! Al Qaida était l’ennemi n°1 depuis 2001 alors que personne en dehors des spécialistes ne la connaissait avant le 11 septembre. Sa déchéance a-t-elle mis fin au Jihad ? Daech éliminé, Boko Haram ou d’autres chercheront à prendre le relais. Sans manquer de candidats à l’attentat-suicide en Europe.
Si nous pensons que les terroristes sont des monstres que l’on peut éradiquer, si l’on croit que vaincre militairement Daech suffira à éteindre l’envie de Jihad du Moyen-Orient et d’ailleurs, c’est se tromper lourdement. Le jihadisme est une hydre dont les têtes repoussent au fur et à mesure qu’on les coupe. Nous avons la mémoire courte ! Al Qaida était l’ennemi n°1 depuis 2001 alors que personne en dehors des spécialistes ne la connaissait avant le 11 septembre. Sa déchéance a-t-elle mis fin au Jihad ? Daech éliminé, Boko Haram ou d’autres chercheront à prendre le relais. Sans manquer de candidats à l’attentat-suicide en Europe.
Ne pas voir qui sont réellement ces « eux », que ces « eux » sont aussi des « nous », c’est se condamner à couper des têtes toujours plus nombreuses. Je me demandais comment Herakles avait réussi à vaincre l’hydre. On se rappelle qu’il l’a tuée mais (est-ce un hasard ?) on ne mémorise pas qu’il se fit aider pour vaincre l’hydre, sur les conseils d’Athena. Sans son frère jumeau, Iolaos, qui cautérisait les cous tranchés avant que des têtes ne repoussent, Herakles n’aurait pas pu venir à bout de l’hydre de Lerne. Intéressant, non ?
« Nous »
Qui est ce « nous » que l’on a attaqué ? Une réponse s’est imposée reprise en boucle par tous. Je la résume : c’est notre art de vivre français qui est attaqué parce qu’il est à la fois haï ouvertement et secrètement envié. Voir par exemple l’éditorial de Thomas Legrand de jeudi. J’ai moi-aussi sur le moment trouvé formidable la résistance façon bravache : #TousEnTerrasse , #JeSuisAuBistrot,… On aurait pu avoir des appels à la haine, on a eu des appels à boire !
C’était aussi réjouissant de voir comment dans de nombreux pays, on soutenait la France. Les couleurs françaises sur les monuments du monde entier, Obama citant en français les trois termes de notre devise nationale, Madonna chantant la vie en rose, même la Marseillaise au Metropolitan Opera de New York,… tout ça remontait indéniablement le moral et on se sentait fier d’être français ! Alors, où est le malaise ? Ce « nous » conforté, réaffirmé, c’est bien une chance ?
Effectivement je suis heureux de cette rupture avec le pessimisme habituel. Mais de même que je trouvais le déclinisme inapte à rendre compte de la réalité d’une société, beaucoup plus active et innovante que la société frileuse décrite couramment, de même aujourd’hui la découverte soudaine d’une identité « bobo » me semble largement factice.
Ce fantasme médiatique d’un France rassemblée pour défendre son art de vivre n’est pas grave en soi. Encore une fois j’aime mieux ce reflet qu’on me tend que celui d’avant. Mais si le propos se fait trop insistant, si on commence à travers ce « ça, c’est la France » à entendre que tout ce qui est différent n’est pas la France, on aura juste troqué une identité fermée pour une autre. La France n’est ni bobo ni rassie, elle est avant tout multiple. J’entendais hier soir une jeune femme voilée répondre à une question sur son identité par une série de « je suis ». Musulmane, femme, mère, Française,..et bien d’autres choses. Ayons un « nous » inclusif !
Et puis cette logique identitaire, même new look, nous amène à nous définir par rapport aux autres. La France serait « à part » et c’est pour ça qu’elle serait visée. C’est un peu vite oublier les morts russes de l’avion explosé dans le Sinaï, les morts libanais de l’attentat de Beyrouth… et tous les autres avant. Ce qui est visé n’est pas seulement une spécificité nationale, c’est un mode de vie occidental, bien plus général. Londres, Francfort, Barcelone ou New York seront peut-être demain visées. Toute cette glose sur l’art de vivre français apparaîtra alors bien vaine.
Dernier élément de mon malaise à propos de ce « nous », finalement si sûr de lui, c’est qu’il laisse entendre qu’il faut défendre l’existant sans plus se poser de question sur ses failles. Ne risque-t-on pas sous prétexte d’union nationale de ne plus accepter la critique du monde actuel ? Si « nous » sommes en guerre, toute critique risque d’apparaître comme une remise en cause du pacte républicain ou comme une tentative de détournement de l’effort de guerre.
Lorsqu’on s’est ainsi interrogés sur ce « eux » et ce « nous », on voit bien que les distinctions radicales que nous faisons entre « eux les barbares » et « nous les civilisés » ne sont plus si nettes. Qu’on me comprenne bien je ne dis pas que nous sommes semblables mais nous sommes, malgré tout, humains les uns et les autres. Et notre commune humanité nous oblige à nous regarder comme tels. Dans un papier écrit avant les attentats (le 27 octobre) Abdennour Bidar nous interpelait :
Donner à chaque être humain les moyens de cultiver sa propre part d’infini : tel est aujourd’hui ce qu’aucune de nos civilisations ne sait plus prendre en charge mais qu’elle laisse à l’abandon, livrant les uns à une terrible solitude dans leur quête, et tous à une inculture spirituelle qui expose les plus fragiles aux séductions du djihadisme !
Notre crise majeure n’est ni économique, ni financière, ni écologique, ni sociopolitique, ni géopolitique : c’est une crise spirituelle d’absence radicale – dans les élites et dans les masses – de vision d’un sublime dans l’homme qui serait partageable entre tous, athées, agnostiques, croyants. Et s’il y en a un, voilà le vrai visage du totalitarisme aujourd’hui : la conspiration terrible, tyrannique et secrète de toutes les forces intellectuelles et sociales qui condamnent l’être humain à une existence sans aucune verticalité.
« Ce que nous ne faisons pas ».
Je l’ai dit plus haut, je comprends bien la nécessité de mesures comme l’état d’urgence. Le juge administratif, le juge européen sont là pour en surveiller l’usage. Les abus seront donc sanctionnés à défaut d’être toujours évités. On n’a pas créé non plus de zone de non-droit comme avec Guantanamo. Si la vigilance est nécessaire, la question sécuritaire n’est pas ce qui m’inquiète le plus. Pour moi le plus grave est de limiter la réaction aux attentats aux seuls volets policiers, militaires et diplomatiques. Le régalien est bien sûr premier. Pour autant ne doit-on pas questionner enfin radicalement notre modèle occidental si l’on veut « cautériser les plaies de l’hydre avant que les têtes ne repoussent » comme je le disais plus haut ? On peut être pris de vertige face à la multitude des chantiers à ouvrir sur le plan social et économique d’une part, mais aussi sur le plan politique et spirituel. On voit bien que tout se noue autour des deux fléaux de notre modernité : l’hubris et la prédation. La tâche est si immense que nous sommes tétanisés, gouvernants ou citoyens.
Il me semble que la situation dans laquelle nous sommes, nous y avons tacitement consenti par facilité, par démission de notre responsabilité. Nous nous sommes « dépris » du pouvoir. Nous avions le confort et la liberté, ça nous suffisait (même si nous savions qu’une part de plus en plus importante de la population en était exclue). On arrive à un moment où ce confort et cette liberté nous sont retirés, avec violence. Nous sommes à la fois désemparés devant la perte de nos acquis et désarmés pour les reconquérir. Si l’on veut reprendre la main, le chantier prioritaire est pour moi celui de la démocratie. Face à notre perte de maîtrise de l’avenir nous devons réinventer un « pouvoir d’agir ». Sans laisser en dehors, ni les plus pauvres ni les plus riches, puisque c’est notre monde excluant qui amène à la guerre.
C’est la raison pour laquelle je trouve capitale la réflexion lancée par Démocratie Ouverte à la suite des attentats. Armel Le Coz invite ainsi à une action « complémentaire [à la réaction sécuritaire/militaire] sur le plan social/sociétal et le long terme (quelque chose qui prenne en compte les causes profondes qui mènent certains jeunes français à prendre les armes contre d’autres jeunes français) ».
La première urgence est pour moi celle de la réappropriation de la parole politique par les citoyens eux-mêmes. Notre « capacité relationnelle », cette habileté sociale, comme disent les Québécois, est capitale. On a trop négligé l’importance des mots, de leur maniement, de leur ajustement. Et si la suppression de tout apprentissage de la rhétorique avait été une de nos plus graves erreurs collectives ? La parole argumentée est la brique de base de la démocratie. Elle est à la portée de tous les citoyens. Les Grecs faisaient de cet égal accès à la parole, l’isegoria, le principe de base de leur démocratie.
En janvier dernier, j’avais évoqué avec Jean-Pierre Worms la nécessité d’un téléthon de la fraternité pour faciliter la création de temps/espaces de dialogue entre citoyens partout sur le territoire. Et si on s’y mettait cette fois ?
La seconde urgence est celle de l’activité (et non de l’emploi). Je pense qu’il faut soutenir l’initiative d’ATD Quart-Monde et de ses Territoires zéro chômeur de longue durée. Nous continuons à raisonner en termes d’emploi alors qu’il est urgent de regarder la question à l’inverse, par l’entrée « activité », Jean Boissonnat le disait déjà il y a 30 ans. L’expérimentation lancée par ATD Quart Monde a une ambition à la hauteur de l’enjeu mais à une échelle trop restreinte. Ne peut-on regarder avec eux comment lui donner plus d’ampleur avec l’appui des mouvements citoyens ?
Troisième urgence enfin : contribuer à ramener les plus riches d’entre nous dans la construction d’un monde commun. J’ai déjà dit ici qu’il devrait y avoir une contribution librement affectée sur tous les revenus du capital. Ne pourrait-on pas lancer une campagne pour que les grandes fortunes françaises abondent un fonds ou une fondation abritée par la Fondation de France pour financer les deux urgences précédentes ?