La « France catholique touchée au cœur » disent médias et politiques en boucle… Vraiment ??
Les terroristes ont gagné. L’emballement politico-médiatique est total. Plus rien ne semble pouvoir l’arrêter. L’écart n’a jamais été aussi grand entre les faits et leur écho. Qui aurait imaginé que l’assassinat d’un vieux prêtre dans une petite paroisse périurbaine ferait un jour l’objet d’éditions spéciales de tous les journaux télévisés et provoquerait le déplacement immédiat du président de la République et du ministre de l’Intérieur ? « La France catholique est touchée au cœur » disaient en boucle les journaux radio et télé. Le président lui-même reprenait cette expression de « France catholique ». La soif de symbolique pousse à des généralités profondément absurdes. Plus personne ne parle de « France catholique » parmi les chrétiens ! Nous parlons seulement de l’Eglise en France. En France et non « de France », pour bien montrer que l’Eglise ne s’approprie pas les Nations mais qu’elle ne s’y réduit pas non plus. L’Eglise est universelle (c’est d’ailleurs ce que signifie le terme de catholique). La « France catholique » sonne à mes oreilles comme un vieux rappel de ce que fut la chrétienté. Une page d’histoire à jamais vieillie… et dangereuse à faire revivre. Avec ce terme je me sens ramené à une identité que je refuse absolument : franco-catholique. Je suis français et catholique. Le ET est essentiel !! car j’y ajoute beaucoup d’autres ET pour construire mon identité, volontairement multiple. Je suis aussi mari, père, fils, consultant, blogueur,…
Il n’y a pas de France catholique comme il n’y a pas non plus d’évêque de Normandie ! François Hollande, devant les caméras, pour bien montrer toute l’importance qu’il accordait à l’événement, annonçait que dès ce soir il recevrait « l’évêque de Normandie ». On avait bien vu dans ses yeux l’hésitation au moment de dire de quel évêque il s’agissait. Rappelons qu’on est évêque d’un diocèse et que la carte des diocèses correspond à peu près à celle des départements. De plus la coutume veut qu’on désigne l’évêque par le nom de la ville où siège l’évêché et nom par le nom du département et encore moins de la région. On dit l’évêque d’Angoulême et non l’évêque de Charente ou, plus bizarre encore, de Nouvelle Aquitaine ! Une erreur anodine ? Oui, assurément si elle est isolée. Mais on ne peut pas parler en même temps de « France catholique » et d’ « évêque de Normandie ». Parler d’évêque de Normandie c’est montrer en réalité qu’il n’y a pas de France catholique puisque le représentant de la France ne sait pas comment se nomment les évêques ! Cette manière de parler de l’évêque laisse voir que le président n’est pas catholique ni même de culture catholique. C’est pour lui un univers étranger. Alors l’association des termes France et catholique apparait dès lors pour ce qu’elle est : une manipulation symbolique. Le terme sera peut-être jugé outrancier mais comment nommer cet assemblage des symboles ? Les symboles ne sont pas anodins, ils sont au contraire terriblement actifs en ce moment. Il n’est donc pas nécessaire de les manipuler au sens premier du terme. En chimie au lycée, nous étions mis en garde face au risque d’explosion quand on mettait en contact deux substances a priori chacune anodine. Il y a des associations explosives de mots. J’aimerais bien qu’on ne joue pas à l’apprenti chimiste au sommet de l’Etat et dans les journaux télé.
Hélas, parce que les terroristes ont déjà gagné, chaque acte criminel est traité sur le mode de l’hyperbole symbolique. A Nice ne s’est pas attaqué à des promeneurs mais à la fête nationale. En novembre cela avait été « l’esprit français », et en janvier « la liberté d’expression ». On ne pouvait pas simplement dire qu’un vieux prêtre venait être victime d’un crime odieux déguisé en acte terroriste. Je lisais l’autre jour qu’il fallait arrêter de nommer ces assassins pour éviter de leur donner la gloire posthume à laquelle ils aspirent. Je crois qu’il faut aussi que nous cessions de manipuler des symboles en restant dans la vérité absurde et triviale des faits.
Un vieux prêtre de 86 ans s’est fait égorger ce matin alors qu’il disait la messe devant quelques rares fidèles parce que nous sommes tous pris dans une spirale folle qu’il nous faut absolument rompre en revenant à la vérité des faits.
Voilà ce que j’aurais aimé entendre ce midi dans la bouche du président.
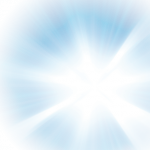 Pour dire la couleur blanche, le latin avait deux mots albus et candidus. L’aube au blanc laiteux vient d’albus. Le candidat vient de candidus, le blanc étincelant des toges des candidats aux fonctions électives de la République romaine. A noter notre mot blanc ne vient pas du latin, mais comme candidus il désigne d’abord le blanc éclatant, du haut-allemand blank, l’éclat métallique des armes… blanches.
Pour dire la couleur blanche, le latin avait deux mots albus et candidus. L’aube au blanc laiteux vient d’albus. Le candidat vient de candidus, le blanc étincelant des toges des candidats aux fonctions électives de la République romaine. A noter notre mot blanc ne vient pas du latin, mais comme candidus il désigne d’abord le blanc éclatant, du haut-allemand blank, l’éclat métallique des armes… blanches.
