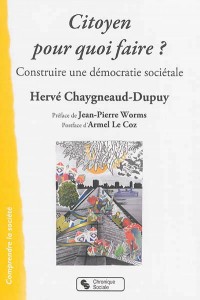Tout le malaise démocratique actuel est dans cette vidéo, toutes les interrogations, toutes les incompréhensions, toutes les frustrations. On y voit le manque de confiance et de culture commune qui rendent les fossés infranchissables, l’incapacité à s’entendre (au sens propre du mot !). Ce débat introductif à la Nuit des débats dans les premiers jours de Nuit debout est une fable, un récit vivant, presque une fiction du réel tant la dramaturgie est forte. Dans une mise en scène quasi-religieuse (on est dans une église), on est en phase, tour à tour, avec chacun des protagonistes qui a une part de vérité, mais aussi soudainement exaspéré par des attitudes en contradiction avec les propos tenus. On voit l’incohérence des personnes de Nuit debout qui expriment leur colère mais ne veulent pas discuter. Anne Hidalgo, qui expliquait longuement quelques minutes plus tôt le besoin d’horizontalité, retrouve toute la verticalité de la Maire de Paris face à une quidam qui ose lui demander des comptes à propos des réfugiés. Edwy Plenel, plus à l’aise avec les perturbateurs, a bien donné son micro au premier qui soit venu jusqu’à lui mais il restera assis sur sa chaise laissant le tribun improvisé agenouillé à ses pieds. Aucune véritable tentative de travailler sur les désaccords, de tenter de les expliciter, de pacifier la confrontation en recherchant cet « accord sur les désaccords » dont parle Patrick Viveret. Ni de la part des journalistes, ni de la part de la Maire qui renvoie à un rendez-vous qu’elle accepte d’accorder (« Je vous recevrai »), ni de la part de ceux qui crient ou prennent la parole.
Comme dans toute fable, l’histoire commençait pourtant bien. Anne Hidalgo prouvait qu’elle envisageait son rôle de manière plus ouverte que bien des élus. Elle citait Pierre Rosanvallon et Dominique Rousseau. Elle affirmait que la politique devait accompagner l’envie des citoyens d’être actifs, au-delà des habituelles concertations de la démocratie participative. Elle concluait de façon assez convaincante : « La politique peut beaucoup si elle part des citoyens ». Edwy Plenel parlait du bouillonnement de la société et diagnostiquait que le mal venait du haut (puisque le poisson pourrit toujours par la tête). Il parlait de la nécrose d’un système que l’on ne peut plus réformer et en appelait à une révolution démocratique.
Mais le débat s’est vite mis à ronronner. Anne Hidalgo décrivait en longueur les réformes qu’il faudrait faire, sans grande originalité. Edwy Plenel, tout à son goût du prêche et sans doute inspiré par le lieu, faisait part à l’auditoire de l’importance de la spiritualité dans la démocratie. L’animateur, journaliste à Mediapart, se rendait compte qu’on frisait le pontifiant, invitant son patron à des réponses plus courtes, sans le moindre résultat. Pas de débat entre les intervenants, pas de débat avec la salle, la Nuit des débats ressemblait de plus en plus à une conférence au collège de France !
L’intrusion devenait la seule issue. Et elle vint, vers la 35ème minute. Brouhaha, distribution de tracts puis interruption et prise de parole, acceptée d’abord avec le sourire. Le propos est clair : « Nous ne revendiquons rien, nous prenons ». Dès lors les cris reprennent, d’autres prises de parole ont lieu au micro ou de la salle. Policées ou virulentes mais sans perspective de débat. « Ces politiques qui nous laissent la parole de temps en temps quelques minutes, on ne discute plus avec eux ! » A la fin, de la salle, obstinément, avec force et en détachant chaque syllabe, quelqu’un assène : « On ne veut pas par-ti-ci-per ! » Au geste qu’il fait (ses deux mains tracent un cercle), on comprend qu’il veut qu’il n’y ait plus d’un côté ceux qui parlent et de l’autre ceux qui participent mais que tous échangent ensemble en cercle. Mais c’est fini et Anne Hidalgo se lève. Vient alors l’épilogue, désespérant. On retrouve maintenant sur scène, une femme qui voulait absolument parler des réfugiés et qui apostrophait depuis un moment la Maire depuis la salle. Elle a désormais le micro. Elle ne crie plus mais parle toujours avec beaucoup de véhémence, exigeant de la Maire des réponses sur la destination des femmes et des enfants arrêtés par les CRS. Elle a attrapé un micro-cravate abandonné sur la table basse ; elle ne s’est pas relevée. « Où ils vont ? Où peuvent-ils aller ? ». Elle parle à genoux devant les trois intervenants, debout, qui lui font face avant de se retirer sans répondre. On entend juste la Maire dire en partant de manière un peu automatique : « Bon, merci… »
Fondu au noir sur la salle qui commence à se vider, un peu remuée, un peu hésitante sur ce qu’il convient de penser et de faire.
Je ne fais pas cette exégèse de vidéo pour distribuer des bons et des mauvais points. Ni pour renvoyer dos à dos Nuit des débats et Nuit debout. J’ai une affection sincère pour toutes les personnes (les personnages ?) que j’ai décrites. La Maire de Paris prouve dans son action qu’elle sait mieux que d’autres « faire avec » la société telle qu’elle est. Plenel est un journaliste qui a eu le courage de créer un nouveau modèle de presse avec Médiapart. Les acteurs de Nuit debout ont su trouver une forme de mobilisation qui donne la parole à beaucoup de déçus de la démocratie actuelle. Elue innovante, journaliste hors-système, citoyens engagés,… on imagine qu’ils pourraient trouver un terrain d’entente. En fait ce sont leurs espaces de parole qui s’excluent mutuellement et leur collision ne peut rien produire de positif.
La nuit des débats n’en reste pas moins une formidable initiative qui montre qu’une municipalité peut inviter à autre chose qu’à des fêtes (Nuits blanches à Paris, Nuits sonores à Lyon,…), on plus exactement peut inviter à faire de la réflexion une fête ! Déjà il y a quelques années, l’université de tous les savoirs avait permis au grand public de découvrir des penseurs exigeants comme Françoise Héritier, Irène Théry ou François de Singly ( pour citer quelques-uns de ceux que j’avais découverts à cette occasion). Ce ne sont pas réellement des débats, plutôt des occasions de penser et c’est en soi très utile.
La nuit debout est complètement sur un autre registre. Elle est une tentative de réappropriation de la parole politique hors de toute appartenance partisane ou allégeance préalable. Elle permet à tout un chacun d’expérimenter la construction d’une parole collective. Avec des codes, des règles qui s’inventent ou se réapproprient de place en place (Puerta del Sol, place Tahir,…). C’est une parole d’émancipation qui ne prend tout son sens que de l’intérieur, quand elle est vécue e partagée. Le filtre des médias en limite la portée à des pratiques sympathiques mais sans portée comme les mains qui s’agitent en signe d’acquiescement. Si j’ose me permettre, il y a dans les Nuits debout l’équivalent des Gymnase clubs : on y exerce non ses muscles mais sa souplesse argumentative ! Autrefois il y avait des cours de rhétorique, on a impérativement besoin de lieux d’apprentissage du débat.
Pour autant – et ceux qui ont connu l’expérience des Ateliers de la Citoyenneté s’attendent sans doute à cette conclusion – je pense qu’il faut aussi des lieux tiers qui permettent de lier questionnement et transformation, réflexion et action. Il faut à la fois imaginer un autre monde possible et agir dans ce monde avec la réalité telle qu’elle est. C’est sans doute plus difficile et moins gratifiant de dialoguer avec des entreprises ou des élus pour les embarquer dans des mutations progressives que de refaire le monde à partir de ses rêves… mais c’est certainement plus utile, même pour réussir des transformations radicales.
On manque de lieux qui fassent le pont entre les mondes, de « centres d’échange » comme je l’évoque dans Citoyen pour quoi faire ? Sans vouloir faire de la pub à outrance, je crois quand même que mon livre donne des éléments de réponse utiles ! Il est paru chez Chronique sociale et disponible pour la modique somme de 12€90. Ici.